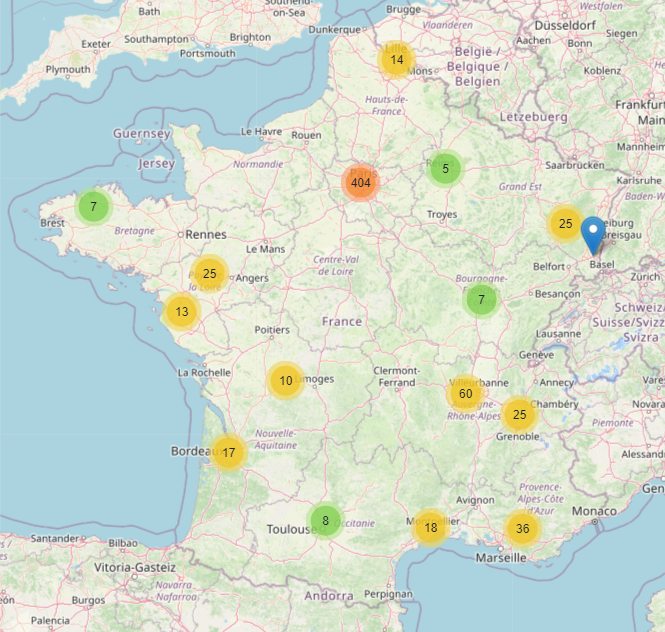M.à‑j. : 1 février 2022
Le marché, surtout américain, cote beaucoup d’entreprises encore jeunes en forte croissance (les fameux growth stocks ou actions de croissance). Souvent, elles ne sont pas encore rentables. Le traditionnel PER et les autres ratios apparentés ne peuvent donc être calculés. Comment analyser ce type d’entreprise ? L’exercice est délicat, mais je vous propose de partager ici quelques pistes que j’applique à mon portefeuille.
La thématique des growth stocks fait parler d’elle depuis quelques années. Le Covid 19 n’a fait que renforcer cette tendance en donnant un coup de boost de plusieurs années à la transition numérique.
Ainsi, en 2020, le fond ARK Innovation (ARKK) de Cathie Wood a enregistré une performance de +150% avec des positions comme Tesla, Roku, Zoom, Square, Shopify, Spotify, Twillio, Docusign ou Sea ltd. Sur Twitter, Puru Saxena, un gestionnaire de fond dont les performances restent non vérifiables, compte plus de 200 000 followers qui suivent l’évolution de son portefeuille composé de titres comme AirBnb, MercadoLibre, Uber, Upstart et Adyen.
Point commun entre toutes ces actions ? Elles ne sont pas rentables (ou commencent à peine à l’être), mais leur croissance attendue est très forte. Leur performance en bourse depuis 2 ans est impressionnante. Les +300% ne sont pas rares ! Forcément, ça suscite de l’intérêt. L’analogie avec les Google, Facebook ou Amazon — non rentables pendant des années avant de devenir des cash machines — finit de faire rêver.
Certains crient à la bulle et dénoncent les gestions à la Cathie Wood qui ne feraient que surfer sur une vague spéculative sans précédent. D’autres pensent que « cette fois les choses sont différentes » parce que la numérisation du monde est une véritable révolution. Il y a surement du vrai des deux côtés : les valorisations de certaines actions sont délirantes, mais celles qui tiendront leurs promesses devraient à terme devenir de très bons investissements.
Essayons d’y voir plus clair dans la méthode à adopter pour analyser ce type d’action, car quoi qu’on en pense, suivre aveuglément les nouveaux gourous de la finance (qui n’ont fait leurs preuves que depuis quelques mois) me paraît plus que risqué.
NB : J’exclus ici les biotechs qui ne réalisent pas un centime de chiffre d’affaires comme on en trouve dans un autre ETF de Cathie Wood (ARK Fintech Innovation ARKF) Y investir demande une expertise scientifique très pointue. Je préfère me concentrer sur les entreprises qui ont déjà une activité, avec de vrais clients, mais qui ne sont pas encore rentables. Elles sont nombreuses dans le secteur technologique.
Un préalable : utiliser les bons ratios
Souvent, en l’absence de bénéfices, le seul ratio pertinent est le ratio Prix sur Chiffre d’affaires (ou Price/Sales en anglais que l’on abrège souvent P/Sales ou P/S). Il nous dit tout simplement combien de fois la capitalisation boursière (Price) représente d’années de ventes ou de chiffre d’affaires (Sales).
Si une entreprise a un P/Sales de 5, elle se paye cinq fois son chiffre d’affaires. C’est déjà pas mal, mais beaucoup d’entreprises du secteur du Cloud ou du SaaS se payent bien plus cher.
Parfois, lorsque l’entreprise s’approche de la phase bénéficiaire, l’EBITDA est positif, ce qui permet d’utiliser le ratio EV/EBITDA. EV désigne la valeur de l’entreprise ou Enterprise Value1Formule de calcul : Capitalisation boursière + dette — cash et EBITDA le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ou Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. L’EBIDAT donne une première approximation de la rentabilité du processus d’exploitation de l’entreprise. Pour une entreprise de croissance, un EBITDA positif est de bon augure. Il signale que l’entreprise est déjà rentable indépendamment de ses sources de financement, des impôts et des jeux d’écritures comptables.
Comme pour le PER, ces ratios peuvent être calculés à partir des données du dernier exercice comptable, c’est le cas le plus simple, mais aussi le plus tourné vers le passé. Heureusement, on trouve souvent un calcul effectué sur les ventes ou l’EBITDA pour les quatre derniers trimestres publiés, le ratio est alors généralement accompagné du signe TTM pour Trailing Twelve Months (douze derniers mois). Les ventes ou l’EBITDA peuvent aussi être estimés sur l’année en cours, la mention Forward est alors utilisée.
Une vraie croissance
Ça parait stupide, mais lorsque vous investissez pour la croissance, il faut tout d’abord vérifier que la croissance est bien là. On parle ici bien entendu de la croissance du chiffre d’affaires parce que ces entreprises ne génèrent souvent pas de bénéfices. Ce n’est d’ailleurs pas ce qu’on leur demande à ce stade.
Sur le marché américain, il n’est pas rare de voir des entreprises s’échanger à un P/Sales de 25, voire 50. Dans ce cas-là, il faut être très exigeant sur la croissance. Pour un P/Sales de moins de 10, on peut avoir l’un des indéboulonnables GAFAM avec une croissance de 20% par an. Si on paye deux ou trois fois plus, il faut nécessairement une croissance bien plus forte.
Une approximation pour prendre la mesure des ordres de grandeur : si une action se paye un P/Sales de 40, il va lui falloir croitre pendant sept ans au rythme de 35% par an avant d’arriver à un PER de 16 si on estime sa marge opérationnelle future à 30% (ce qui est très bon). Dans le passé, très peu d’entreprises ont réussi à faire aussi bien.
Ensuite, la croissance doit être évaluée par action. Il faut donc garder un œil sur le nombre d’actions en circulation Une entreprise peut très bien croitre à coups d’augmentation de capital. Les émissions d’actions diluent la part des anciens actionnaires qui ne profitent en rien de la croissance globale de l’entreprise. Plus insidieux que les augmentations de capital : le personnel et les dirigeants rémunérés avec des actions nouvelles. C’est une pratique courante dans la tech pour attirer des talents et les garder. Même les GAFAM en usent encore aujourd’hui. Cette pratique, que l’on trouve généralement dans le rapport annuel sous la ligne Stock Based Compensation, doit toutefois être maitrisée pour ne pas porter préjudice aux actionnaires. Elle ne doit pas absorber toute la croissance de l’entreprise, surtout lorsque la rentabilité est en vue et que l’entreprise sort de sa phase de développement accéléré.
Un espace pour croitre suffisant
Au bout d’un certain temps, même les plus belles entreprises de croissance ralentissent leur expansion. Dans l’idéal, il faut que ce moment arrive le plus tard possible. C’est d’autant plus vrai si on paye un prix important.
Évaluer ce moment est difficile, beaucoup de choses peuvent mal se passer ou changer un marché. Une donnée peut toutefois aider : le TAM pour Total Addressable Market (en français marché total adressable ou encore marché total disponible). Il s’agit du marché sur lequel opère l’entreprise. Plus il est vaste, plus l’entreprise en question en a une petite part, plus l’espace pour croitre est vaste.
Bien sûr, il faut réfléchir un minimum. Il est impossible qu’une seule entreprise s’approprie l’ensemble du TAM, mais son évaluation peut déjà vous indiquer si l’horizon est bouché ou pas. C’est déjà pas mal. Il faut aussi tenir compte de l’évolution prévisible du TAM. S’il est en croissance, c’est très bien, mais il faut alors vérifier que l’entreprise croit au moins aussi vite que son TAM, sinon ça veut dire qu’elle perd des parts de marché ! Certaines entreprises comptent aussi conquérir de nouveaux marchés une fois un premier marché conquis (optionality) ou lancer des produits dans de nouveaux secteurs. Leur TAM peut s’élargir fortement si les projets aboutissent, mais cela est forcément plus incertain.
Un business scalable
Les meilleurs business sont ceux qui bénéficient d’un point mort de rentabilité assez bas avec des charges variables qui ne bougent presque pas. Le saint Graal consiste donc à trouver une entreprise qui va pouvoir maintenir longtemps une croissance forte sans augmenter ses coûts en proportion. Mécaniquement, ce type d’entreprise deviendra TRÈS rentable avec le temps.
C’est le cas de beaucoup d’entreprises de logiciels. Ce n’est pas pour rien que Microsoft a gagné si vite autant d’argent ! Une fois le coût du développement d’un logiciel amorti, chaque exemplaire vendu est du bénéfice presque pur. À l’époque où les logiciels se vendaient dans des boites, le business du software était déjà particulièrement rentable. Aujourd’hui, la plupart des entreprises du secteur basculent vers un modèle d’abonnement. Ça augmente très légèrement leurs coûts fixes (il faut bien payer l’hébergement des logiciels qui s’exécutent à distance), mais ça apporte surtout des revenus récurrents ! La vente sur abonnement d’un logiciel déjà amorti est de l’or en barre.
Une marge brute élevée
Même si l’entreprise n’est pas encore profitable, il est généralement possible de se faire une idée de son potentiel en regardant sa marge brute ou gross margin en anglais. Il n’est pas rare d’avoir des entreprises en croissance avec des marges brutes très élevées (> 75%). C’est bon signe pour la suite. Si la marge se maintient depuis plusieurs années à des niveaux élevés, c’est encore mieux.
Pour comprendre pourquoi une marge brute élevée et durable est bon signe, il faut se rappeler ce que représente la marge brute : la différence entre les prix des ventes hors taxes et les coûts de revient des biens ou services. Elle donne donc une première approximation de la valeur qu’une entreprise crée. Elle indique aussi que cette valeur n’est pas captée par ses fournisseurs et prestataires.
Bien entendu, une marge brute élevée attire la concurrence. D’autres entreprises vont tenter, tôt ou tard, de conquérir ce qui se présente comme un marché très juteux. C’est là où la stabilité de la marge dans le temps est capitale. Une marge brute qui se maintient à des niveaux élevés depuis des années est le signe d’une entreprise qui résiste à la concurrence. Elle est sans doute dotée d’une sorte d’un avantage concurrentiel pour résister ainsi à une concurrence qui a forcément essayé de l’imiter2Voir ce sens : « What Gross Margins Can Tell You About a Company’s Economic Moat », oldschoolvalue.com.
Un business non réplicable
Pour que le plan se déroule sans accroc, la concurrence doit être tenue à distance aussi loin que possible. L’entreprise doit avoir un savoir-faire, une marque ou une renommée qui interdit à un concurrent de lui prendre des parts de marchés. Il ne doit pas être possible de faire la même chose en moins cher. C’est le fameux moat de protection cher à Warren Buffett.
Par exemple, les compagnies aériennes ont souvent un très faible moat car elles proposent toutes plus ou moins le même service. Elles n’ont d’autre choix que de se battre sur les prix. À l’inverse, concurrencer Google sur son moteur de recherche est très difficile (avance technologique). C’est la même chose avec Apple ou Coca-Cola du fait de la renommée de ces marques et de leurs produits. Une entreprise de croissance aura nécessairement un moat plus faible ou moins visible parce qu’elle est à un stade de développement moins avancé. Il reste tout de même indispensable de se demander si un concurrent pourrait venir sur ce marché s’il y mettait les moyens. Car, si le business est de qualité, les concurrents trouveront les moyens de se financer.
Dans le domaine du Cloud et du SaaS, une manière assez commune de se constituer un moat est tout simplement d’être l’un des premiers sur le marché. Les entreprises qui adoptent une solution logicielle sont souvent très réticentes à en changer, car cela représente des coups et un risque de désorganisation. Ainsi, de nombreux clients se trouvent captifs. Certaines solutions sont d’ailleurs détestées, mais continuent à prospérer sur leurs acquis (je pense à Citrix ou même à Oracle). Bien entendu, le but n’est pas de fournir un mauvais service dont les clients seraient prisonniers. Il s’agit simplement de prendre en compte les facteurs d’inertie et la force des habitudes dans l’adoption d’une technologie. Ils sont à l’origine d’un phénomène souvent observé dans la tech : the winner takes it all (le gagnant remporte tout). Les exemples sont nombreux : Microsoft avec Windows et Office, Adobe avec Photoshop, Google avec son moteur de recherche, etc.
Un leadership et une vraie stratégie
Lors de sa phase de croissance initiale, l’entreprise ne doit pas simplement être gérée au mieux. Il faut tout construire : les produits, les équipes, la stratégie, l’image, les partenariats, etc. Le succès d’une entreprise de croissance est donc intimement lié aux talents de ses dirigeants. Il s’agit d’un élément capital qui peut tout faire échouer !
La première qualité requise est de disposer d’un fort leadership, c’est-à-dire une capacité à être écoutés et respectés. C’est à cette condition que le dirigeant pourra mettre en œuvre une stratégie ambitieuse. Sa personnalité doit donc être à la fois visionnaire et pragmatique. Il doit aussi être assez souple pour savoir adapter sa stratégie à la réalité de sa mise en application.
Évaluer les talents d’un jeune dirigeant est a priori hautement subjectif, mais les ingrédients d’un futur succès sont là très tôt. Nous connaissons tous des fondateurs qui ont mené très loin le développement de leur entreprise. On pense à Bill Gates avec Microsoft, Jeff Bezos avec Amazon, Mark Zuckerberg avec Facebook ou Elon Musk avec Tesla. En France, il y a Bernard Arnaud avec LVMH ou Xavier Niel avec Iliad.
De manière générale, je vois très positivement les entreprises dirigées par leur(s) fondateur(s). Pourquoi ? Car un fondateur est forcément un visionnaire. Il a déjà pris énormément de décisions qui se reflètent dans l’ADN de l’entreprise. Il sait comment elle réagit. Il connaît parfaitement ses marchés. C’est celui qui a la vision la plus lointaine pour l’entreprise parce qu’il y pensait avant même sa création. Par la force des choses, il dispose aussi d’un fort leadership auprès de ses équipes et des diverses parties prenantes.
Attention, il ne s’agit pas de faire aveuglément confiance à tous les fondateurs ! Regardez ce qu’ils ont déjà réalisé. Écoutez ce qu’ils disent. Est-ce un discours convaincant ? Est-ce le discours d’une personne réellement honnête et compétente ? Est-ce que les promesses passées ont été tenues ? Il y a aussi des doux rêveurs, voire des arnaqueurs purs et simples. Le cas de Trevor Milton, le fondateur de Nikola, est emblématique : un fondateur au discours vague et trop vendeur s’est révélé être un truqueur de première. Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos (qui s’est être révélé une fraude pure et simple) affichait elle des promesses trop belles pour être vraies accompagnées d’un culte du secret inquiétant. Pour repérer ce type de profil, essayez aussi d’être attentif à ce que Philip Fisher appelait les commérages. Ils révèlent souvent les incompétents et les malhonnêtes.
Parfois les fondateurs ne sont plus aux commandes, mais le management est tout aussi excellent. C’est ce qui s’est passé lors de la passation de pouvoir chez Google. Les jeunes fondateurs électrons libres ont laissé place à des experts hautement qualifiés. Ce type de transition est parfois nécessaire, particulièrement lorsque l’entreprise dépasse une certaine taille ou niveau d’expertise et que la fougue des débuts pourrait devenir un handicap.
L’important, c’est que le leadership et la stratégie soient toujours là.
Un portefeuille DIVERSIFIÉ
Je ne suis pas vraiment d’accord avec la célèbre citation de Warren Buffet « la diversification, c’est pour ceux qui ne savent pas ce qu’ils font », mais ici elle est très adaptée. Parce que dans ce type de dossier, il est tout simplement impossible de tout savoir ! En premier lieu, parce que l’horizon de temps est long.
Investir sur des entreprises en forte croissance alors qu’elles ne sont pas encore rentables, c’est prendre des risques. C’est prendre infiniment plus de risques que d’acheter des entreprises déjà matures. Tant de choses peuvent mal se passer.
Investir sur une entreprise de croissance, c’est donc prendre le risque de tout perdre. Investir sur 10 entreprises de croissance augmente les chances d’avoir des échecs, mais aussi des réussites. Comme toujours, la diversification dilue le risque, mais ici le risque est particulièrement important.